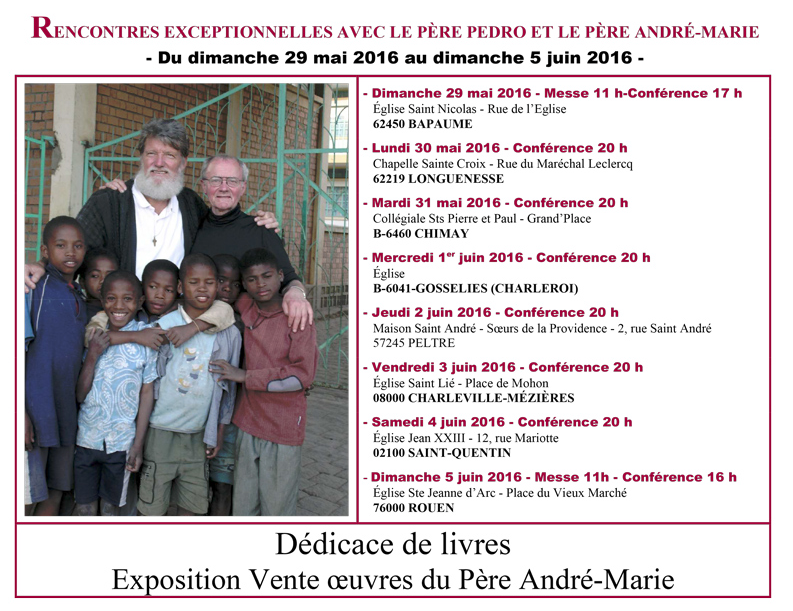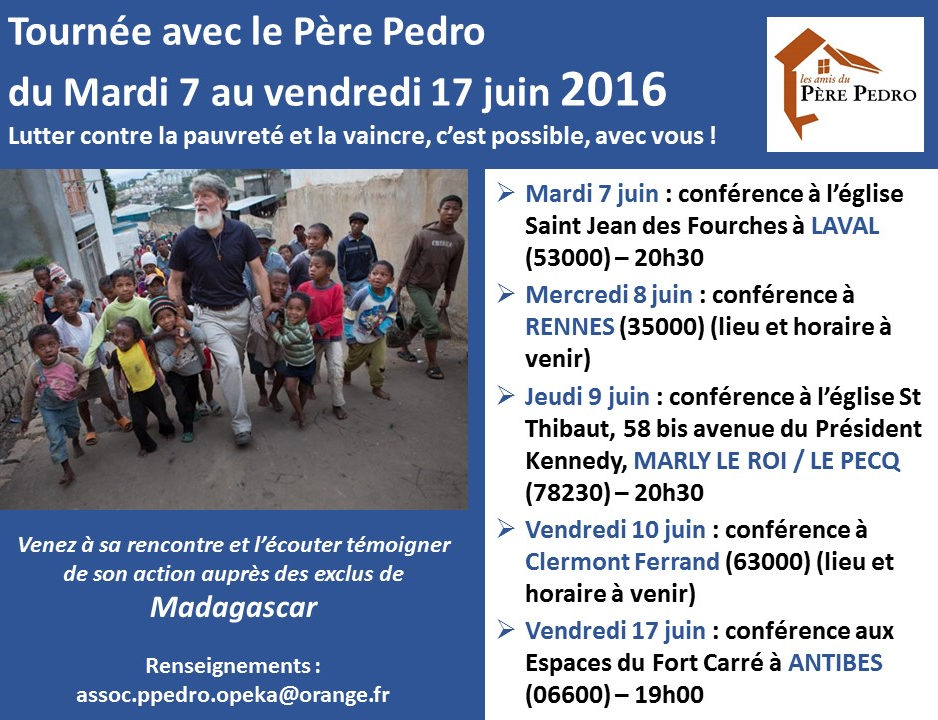Mardi 29 mars, en ce jour de commémoration des insurrections des patriotes malagasy qui demandaient l’Indépendance en 1947, les comités des 3 villages Akamasoa d’Andralanitra, Ambaniala et Ankadiefajoro, sont venus me voir pour une triste raison.
Avec eux, 9 jeunes, des garçons de 20 ans environ, dont 3 sont déjà mariés avec enfant, qui ont commencé à commettre des larcins en ville. J’avais été prévenu par les responsables quant à la dangerosité de ces jeunes qui, non contents de voler, font peur et menacent les habitants des villages d’Akamasoa, dans le cas où certains s’aventureraient à les dénoncer.
A Akamasoa nous ne tolérons pas les menaces. C’est pour cela que j’ai convoqué ces jeunes immédiatement après avoir pris connaissance de leurs faits. Et ce mardi matin, je les ai fait venir à Andralanitra pour les rencontrer face à face, les yeux dans les yeux, afin de dialoguer avec eux et essayer de comprendre pourquoi ces jeunes, après avoir grandi à Akamasoa, autour de la décharge bien sûr, mais dans cette famille solidaire que nous avons créée, sont tombés dans cet abîme de violence, de vol et de mensonges.
Et là, je me suis retrouvé devant des jeunes désorientés et victimes. J’ai vu dans leurs visages des enfants oubliés par leurs parents et la société.
Une situation incompréhensible
Le comble est qu’une maman de ces jeunes était présente : une maman qui comptait parmi ces 9 brigands, 3 de ses fils ! Une femme déjà âgée, épuisée par la dureté de la vie, que je connaissais très bien et qui m’avait toujours inspiré confiance, une personne calme et respectueuse, connue comme telle dans le village.
Je me demandais : comment cette mère a pu laisser ses 3 enfants se perdre dans la drogue, l’alcool, la prostitution, et ne pas réagir ? Et voilà ce que j’apprends : puisque ses enfants lui rapportaient un peu d’argent tiré de leurs vols, elle était satisfaite, et se taisait…
Quelques responsables parmi les comités de village, surtout des femmes, étaient présentes à cette rencontre, où j’essayais de regarder dans les yeux chacun de ces enfants. Car eux aussi, enfants d’Akamasoa, quand je venais jadis dans leur village, me prenaient la main pour m’accompagner et même, se bagarraient pour savoir qui, parmi eux, serait le plus proche de moi !
La confrontation avec les jeunes
Je leur ai demandé : « comment vous, à qui nous avons donné tant d’éducation, de formation, de bons conseils et en dépit de tous les encouragements reçus, vous avez pu dévier d’une façon si incompréhensible ? »
Ce sont des jeunes déboussolés et victimes qui m’ont répondu, disant : « Parce que nous cherchions du travail pour aider notre mère, nous avons quitté tout doucement les études. A l’invitation des éboueurs, nous sommes allés en ville sur les camions de la décharge pour trouver une occupation. Et c’est là que nous sommes rentrés en contact avec les jeunes des bas quartiers. Nous les avons accompagnés dans leurs vols, et nous avons commencé à vivre du mensonge, de l’astuce, et de la drogue locale, le rongony. »
Je leur ai dit : « Mes chers amis, tout ce que vous avez reçu à Akamasoa doit être encore vivant dans votre cœur, votre esprit ! » Et disant cela, je tapais fortement du poing sur la table à côté de moi, afin d’impressionner ces jeunes que je voyais ailleurs, rien qu’à leurs regards, comme s’ils étaient partis dans un autre univers, celui du chacun pour soi et de la survie. Mais une survie dans le monde de la perdition ! Ces jeunes qui hier encore étaient nos jeunes, mais qui se sont éloignés de nous et de notre travail, par l’esprit, la mentalité, la pensée, et aujourd’hui s’en trouvent très loin.
Vraiment, je cognais avec grand bruit pour les réveiller : « Nous sommes ici à Akamasoa ! Vos parents ne vous ont jamais dit d’aller voler, on vous a même toujours répété que c’était mal, et que nous ne tolérions pas ça ici. Réveillez en vous ces conseils et ces vertus qu’on vous a appris ! Elles sont bien encore en vous quelque part, enfoncées, encombrées ! Et qui est plus en ce jour, où l’on commémore les héros de votre Patrie, ceux qui ont donné leur vie pour que vous ayez une vie meilleure et plus digne! »
Et je frappai une nouvelle fois de mon poing sur la table.
« Si ces héros malagasy se réveillaient, et qu’ils vous voyaient, qu’ils voyaient à quel point vous êtes tombés dans la déchéance et l’abîme du mal, ils seraient tellement tristes qu’ils mourraient une seconde fois. »
Je parlais fort, mais en même temps je les regardais fraternellement, cherchant leurs yeux et leur cœur pour faire revivre en eux ces moments où, enfants, ils avaient été proches de moi, ces souvenirs qui ne sont pas anéantis à tout jamais, mais sommeillent encore quelque part.
Le comité aussi les a encouragés à revenir dans le droit chemin, et de même leurs parents présents.
A la fin, je leur ai demandé : « Regrettez-vous le mal que vous avez fait ? Pensez-vous demander pardon à vos parents, à tous les éducateurs, les responsables d’Akamasoa et à tous ceux qui ont souffert de vos actions ? »
Puis je leur ai dit de se lever, et que chacun dise son nom, et ce qu’il pensait faire désormais de sa vie.
Un par un, tous ont regretté et demandé pardon. Et chacun, après avoir demandé pardon, a formulé la même demande : « mon père donne-moi un travail afin que je puisse me sortir de ce mauvais chemin. »
Ce courage qu’ils ont montré pour reconnaitre leurs défauts m’a frappé, et dans leur assurance farouche j’ai compris qu’ils avaient été marqués et habitués à la vie dure de la rue.
Faute de travail, ils voleront pour survivre
Là, j’ai compris qu’il est facile de donner un conseil, ou de faire un sermon à un jeune qui a dévié et qui est seul dans la société, et sans travail. Mais que justement, c’est le fait de ne pas avoir un travail digne, régulier, qui les a poussés à aller dans la zone interdite, à s’élever contre la société qui les a vus naître.
Et en moi-même je me suis dit : je suis celui qui donne des conseils, qui encourage à changer ; mais si mon rôle s’arrête là et que je ne les aide pas à avoir un travail, alors je ne fais que la moitié du chemin avec eux. Car après ce pardon qu’ils ont demandé, dès demain peut-être, ils recommenceront à voler, parce qu’ils doivent vivre.
J’ai alors demandé aux jeunes de sortir un moment afin de parler avec le comité et les parents.
La responsabilité des dirigeants
« Vous voyez, leur ai-je dit, les jeunes qui n’ont pas de travail régulier et digne, qui leur assure le minimum d’argent pour avoir une vie décente, ces jeunes vont obligatoirement tomber dans le vol, le mal, et suivre les bandes de malfaiteurs qui se créent tous les jours en ville. »
Là aussi j’ai compris combien les responsables de l’Etat sont absents dans ce domaine de la création d’emplois pour leurs jeunes, et que c’est un examen de conscience que devraient faire tous ceux qui ont demandé d’être élus pour diriger le destin d’une Nation. Combien sont responsables tous ces dirigeants qui ne se soucient pas de leur peuple !
Pour ma part, je ne suis pas venu à Madagascar pour créer des emplois, devenir un entrepreneur et un patron.
Je suis venu en tant que frère de ma communauté de Saint Vincent de Paul, et pour servir mes frères les pauvres.
Mais nous avons été obligés, à Akamasoa, par la force des choses, par les plus pauvres qui mouraient de faim et de maladie, et par le bon sens et l’humanité, de créer des emplois et tant d’autres infrastructures pour sauver les enfants et leurs parents.
Cependant, nous ne pouvons pas entretenir des dizaines de milliers d’emplois ! Les quelques milliers que nous avons déjà créés nous permettent de parler et d’hausser la voix, et de crier fort aux responsables qu’il faut sauver les jeunes de ce pays, les aider à revenir à la société, pour qu’ils aient un avenir.
Car on ne peut pas laisser ces jeunes désorientés se perdre dans la drogue, le mal, l’indifférence, le chacun pour soi et, finalement, dans l’anarchie.
Les responsables de l’Etat ne peuvent pas se dédouaner trop facilement de cette responsabilité. C’est un devoir sacré d’un élu que de servir et préparer un avenir digne à ses propres enfants et jeunes. Et je suis écœuré de voir l’indifférence depuis des dizaines d’années face à ce problème, qui a produit toute cette instabilité dans la ville d’Antananarivo et dans le reste du pays.
Il ne faut pas être un diplômé de sociologie pour comprendre cela. Et je crois toujours qu’il n’est jamais trop tard, on peut toujours recommencer ce combat pour la justice sociale et la création de travail pour le peuple.
Après avoir discuté de ces choses avec le comité et les parents, j’ai rappelé les jeunes, et je leur ai dit : « Si vous demandez du travail, on va vous donner du travail ; mais pour un temps limité d’abord, afin que vous puissiez vous ressaisir. Et ensuite on verra, si vous voulez vraiment changer. Mais ça ne vous empêche pas, dans vos moments libres, de chercher un emploi à l’extérieur. »
Nous encourageons en effet toujours dans ce sens, la recherche d’emploi à l’extérieur, car il est impossible à l’infini de supporter cette charge de milliers d’ouvriers que nous avons pris à bras le corps par un devoir humanitaire. Mais notre action dans ce domaine devrait n’être que temporaire… dans l’attente que l’Etat s’occupe de ces jeunes, qu’il encourage la création d’entreprises et l’investissement extérieur.
Sinon, si l’Etat ne prend pas sa responsabilité dans ce domaine, c’est une société où les jeunes vont sombrer dans des bandes de voleurs que nous allons créer, des bandes qui sèmeront la panique et la peur dans tous les quartiers de la capitale et même dans les campagnes.
Ensuite j’ai demandé à chaque jeune de faire une déclaration par écrit de leur repentance, affirmant qu’ils ne voleront plus et qu’ils s’engagent dès maintenant à travailler.
« Si vous ne changez pas, leur ai-je dit, nous ne pourrons pas cautionner vos mauvaises actions, et nous serons obligés, à contre cœur, de vous conduire auprès des responsables des services de l’ordre de l’Etat. Car nous ne pouvons pas accepter qu’à Akamasoa se forment des groupes de malfaiteurs ; c’est un déshonneur et le contraire de ce que nous avons poursuivi. Et surtout cela va à l’encontre de la culture des ancêtres que nous voulons suivre. Parce qu’au lieu de la solidarité et de l’entraide, c’est la violence et la peur qu’on instaure. »
Notre responsabilité devant les jeunes
Je tenais à faire cette réflexion afin que tous ceux qui nous aident savent que devant 14 000 jeunes et enfants dans nos écoles, nous avons un devoir sacré d’empêcher qu’une minorité infime et violente puisse, à Dieu ne plaise, semer le désordre, apporter une mauvaise réputation pour ces milliers de jeunes qui veulent étudier, qui aiment leur Patrie, respectent leurs parents et veulent se sortir de l’extrême pauvreté par les études, les sacrifices, la solidarité, l’amour, et le respect de la culture malagasy.
Nous sommes tous responsables de nos jeunes. Aucun pays ne peut se vanter d’avoir une jeunesse sans problèmes, sans drogue, sans vie facile, sans jeunes désorientés et perdus dans le labyrinthe de la vie. Responsables devant eux quand ils sont enfants, puis adolescents, car à chaque étape il faut les aider à trouver un sens à leur vie.
Ici, à Madagascar, à Akamasoa, que faut-il faire devant ces jeunes qui ne connaissent pas leur voie et qui sont trompés ?
Notre rôle est multiple : éducateur, prêtre, parents et ensuite, comme des entrepreneurs et à la place de l’Etat, donner du travail. Le travail, encore, n’est pas le problème. Du travail, il y en a ; mais l’argent ? Car pour ces 9 jeunes à qui on donne une occupation et la chance de se relever, il faudra trouver à la fin de la semaine l’argent pour payer leurs salaires.
Il faut que les gens sachent combien le travail et le combat que nous menons ici est difficile. Des cas comme ça, on en a plusieurs fois par semaine. Et encore ce matin, avant que je n’écrive ce texte : un jeune qui frappe sa propre mère, l’insulte, parce que la drogue l’a rendu fou …
Le combat continue !